
Louis Barbier dit l'abbé de La Rivière, seigneur de Petit-Bourg
(Sennemont), conseiller du Roi en son conseil d'État, chancelier des
Ordres de Sa Majesté, né en 1593 à
Vandélincourt, près de Compiègne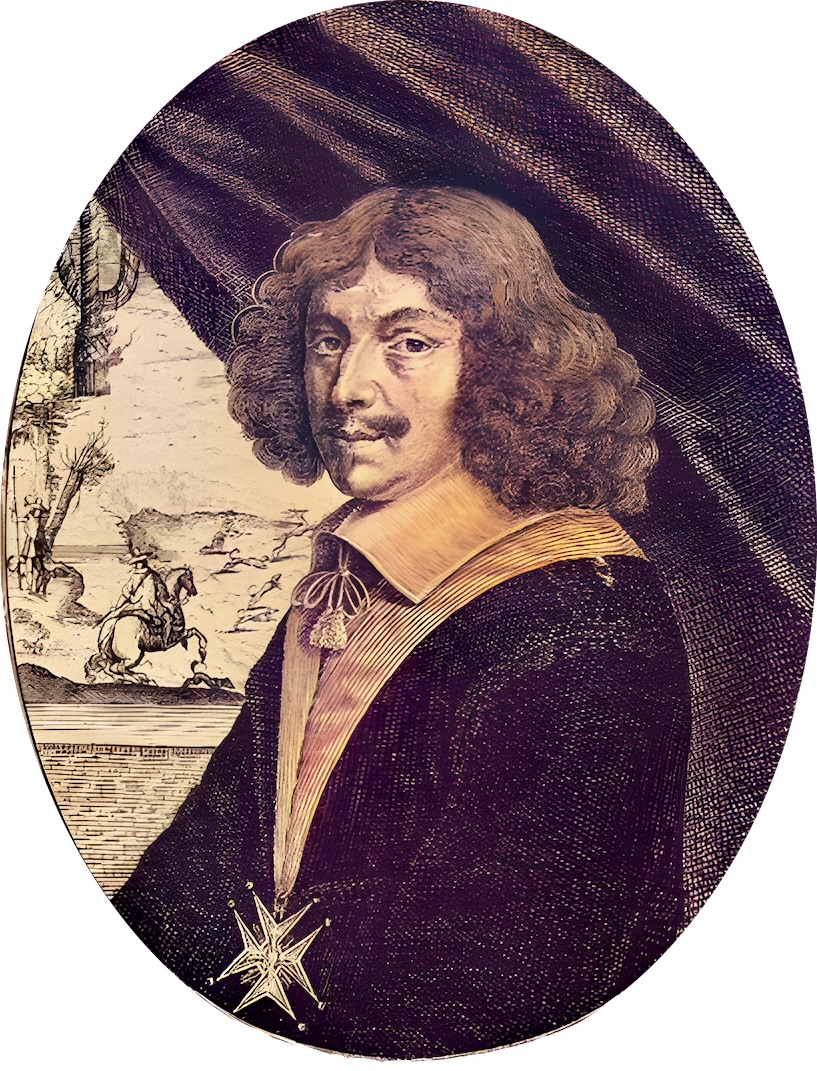 . Fils d'Antoine Barbier dit de La Rivière, commissaire de l'Artillerie en Champagne et de Cécile Le Maire.
. Fils d'Antoine Barbier dit de La Rivière, commissaire de l'Artillerie en Champagne et de Cécile Le Maire.
| Antoine Barbier,
fils de Mathieu Barbier, et de Marie Morel, son épouse en
premières noces. Baptisé le 25 mars 1573, à Vaudelincourt. Il est dit
sieur de la Rivière à son contrat de mariage. Commissaire de
l'Artillerie en 1591 ; contrôleur de la chancellerie et audience de la
Cour de Parlement à Chalons le 16 février 1593 ; archer des gardes du
Roi en 1595. Époux de Cécile Le Maire, fille de Nicolas Le Maire, bourgeois de Montfort-l'Amaury et d'Isabeau Courtin, le 31 mars 1592. Mort en août 1637. |
Louis Barbier est boursier au collège de Lisieux.
Tonsuré le 29 mars 1603.
Régent au collège du Plessis à Paris.
Aumônier de Pierre Habert de Montmort, évêque de
Cahors. En 1621, il est introduit par ce dernier dans l'entourage de
Gaston de France, duc d'Orléans et frère de Louis XIII, alors en
disgrâce. Il devient son Premier-Aumônier et son secrétaire de 1643 au 2 février 1660.
Il est perçu comme un homme fin et adroit, de caractère bas et servile. En outre, d'aspect délicat et fort douillet, prenant le plus grand soin de sa personne. (DETHAN, La vie de Gaston d'Orléans).
En 1626, il devient Premier-Aumônier de Marie-Louise de
Bourbon-Montpensier, duchesse d'Orléans, et obtient la charge de maître de l'oratoire de Gaston d'Orléans, frère du
roi de France.
Aumônier de Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans.
Grand-Aumônier de la reine, Anne d'Autriche,
épouse du roi Louis XIII.
Abbé commendataire de Saint-Père-en-Vallée, au diocèse de Chartres
(abbaye résignée
par l'abbé Philippe Hurault,
seul descendant de la maison de Cheverny, par le décès de son frère
Henri, de l'avis de Gaston d'Orléans, moyennant une pension de 6.000
livres. Le pape Urbain VIII, sur le brevet du roi admit cette
résignation par ses bulles du 14 mai 1635. Prise de possession le 25
juin 1635), abbé commendataire de Saint-Benoît-sur-Loire au diocèse
d'Orléans (en décembre 1642), de Sauve-Majeure, de La Grasse, au diocèse
de Carcassonne, de la Sauve, près de Bordeaux (Archives départementales
de la Haute-Marne, cote G 17), de Notre-Dame-de-Lyre, au diocèse
d'Évreux, chanoine de Saint-Honoré ; il profite
de plusieurs
bénéfices ecclésiastiques.
Il introduit les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur dans l'abbaye de Saint-Père.
Il intrigue durant la Fronde dans la mouvance de Gaston d'Orléans.
Le temps ayant fait son œuvre, il se rapproche du
cardinal Mazarin dont il reçoit les faveurs et le titre de seigneur de
Seinemont. Foi et hommage au chapitre de Saint-Spire par Me Michel Bonnefont, au nom de l'abbé de La Rivière, seigneur d'Évry-sur-Seine et Seinemont, du 21 janvier 1645.
Il est nommé chancelier des Ordres du Roi sur la
démission de M. de Chasteauneuf, Garde des sceaux de France, et garde
des sceaux de l'Ordre du Saint-Esprit le 22 mars 1645.
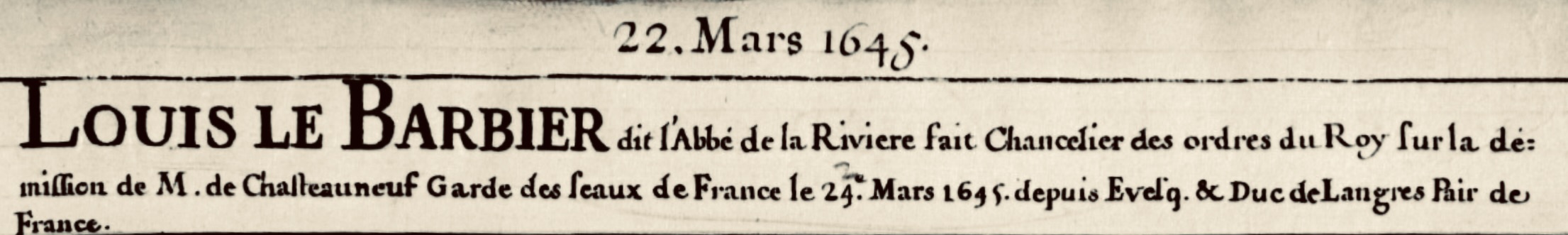
Le 9 novembre 1648, un Placard contre Mazarin et La Rivière est trouvé au bout du Pont-neuf de Paris. Bibliothèque de l'Institut de France, manuscrits de la collection Godefroy, Ms 277-378, cote fol. 237.
En 1650, lors de la réforme du monastère de
Saint-Père, afin de faire taire les nombreuses réclamations des
religieux au sujet de l'important revenu de l'abbaye presque entièrement
en son seul pouvoir en qualité d'abbé commendataire, il promet de
payer 800 livres tous les ans pour les réparations nécessaires à
l'entretien des lieux. Il oublie cependant habituellement sa promesse.
Sourd aux imprécations et faisant fi des plaintes et des menaces.
Le 24 avril 1652, une déclaration est faite devant Jacques Barré, notaire royal en la prévôté de Corbeil, commis pour la confection des terriers et censiers des terres et seigneuries d'Évry-sur-Seine et de Seinemont, anciennement Petit-Bourg, aux termes de laquelle Messire Louis de La Rivière, ministre d'État, chancelier, surintendant et commandeur des Ordres de Sa Majesté, reconnaît qu'à lui appartiennent : la ferme et bâtiment vulgairement appelée la ferme de Saint-Maur, pour ce qu'elle a cy-devant été acquise, par feu le sieur Galand, de Monseigneur l'Illustrissime archevêque de Paris, auquel elle appartenait du doyenné de Saint-Maur, audit archevêché, qui était anciennement le lieu seigneurial de la seigneurie dudit Évry-sur-Seine ; les haute, moyenne et basse justice dans l'étendue de la seigneurie d'Évry-sur-Seine, ressortissant par appel en matière civile en la prévôté royale de Corbeil, et pour les criminelles au Parlement de Paris ; la collation, nomination et présentation de la chapelle de Notre-Dame et de Saint-André, fondée en l'église paroissiale de Saint-Pierre d'Évry-sur-Seine ; des dîmes ; la maison seigneuriale du château de Seinemont ci-devant dit Petit-Bourg, avec les bâtiments, pavillons, jardins, et parc ornés de fontaines, canaux, cascades (...) figures et statues de pierre de liais de marbre, en dépendant ; la ferme de Rouillon ; les censives ; des terres labourables, etc. Archives départementales de Seine-et-Oise, cote G 248 (Liasse) - 8 pièces, papier.
Ordonné prêtre en 1655, le 28 février de la même
année il est nommé évêque de Langres et par voie de conséquence
duc et pair de France. Confirmé le 15 novembre 1655. Il est sacré
le 2 janvier 1656, dans l'abbaye du Lis, près de Melun, par Anne de
Lévis de Ventadour, archevêque de Bourges, assisté de Jean de
Lingendes, évêque de Mâcon, et de François Faure, évêque d'Amiens. Il
prit possession par procuration avant de faire son entrée solennelle la
même année.
| (...) Le sort burlesque, en ce siècle de fer, D'un pédant, quant il veut, sait faire un duc et pair. (Boileau, Satire I.) |
Le 9 juin 1660, il devient Grand-Aumônier de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, épouse du roi Louis XIV.
La Rivière disait du cardinal de Richelieu qu'il
était sujet à battre les gens et qu'il avait plus d'une fois battu le
chancelier Séguier et Bullion. (TALLEMANT, Historiettes. Tome II).
Il semble, à en croire Tallemant des Réaux, qu'il vécu en concubinage avec Mlle
Legendre, à laquelle il légua à sa mort 20.000 livres et que, fort
soucieux de son apparence, il changeait parfois d'habit trois à quatre fois par
jour (TALLEMANT, op. cit.)
 Les armes de Mgr Barbier de La Rivière : d'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes au pied fiché du même, posées deux, une.
Les armes de Mgr Barbier de La Rivière : d'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes au pied fiché du même, posées deux, une.
DAGUIN en 1877, dans Les évêques de Langres. Étude épigraphique, sigillographique et héraldique,
indique que les ouvrages de la bibliothèque de Louis Barbier de La
Rivière sont ornés d'un fer à ses armes accompagnées des attributs
épiscopaux. La bibliothèque de Chaumont (Haute-Marne) possède plusieurs
volumes dont les plats ont été frappés de ce fer. Il cite. Guigard, Armorial du Bibliophile, t. II, p. 31.
Ces armes sont décrites par le Père Anselme (d'azur au chevron d'or accompagné de trois croix au pied fiché de même). Elles figurent sur le vitrail de l'église Saint-Pierre de Chartres, 5e fenêtre de l'étage supérieur à gauche, d'après d'Arnoncourt, Chartres : notes héraldiques et généalogiques, p. 39. (DE L'HORME, Notes généalogiques).
Son sceau épiscopal : ovale, de 40 millimètres
sur 32 millimètres. Armorial : écu à un chevron accompagné de trois
croix au pied fiché ; couronne ducale, surmontée d'un chapeau d'évêque ;
cordon du Saint-Esprit. Sans légende (D'après un dessin manuscrit cote
17035 du fonds latin de la Bibliothèque nationale, p. 263). Nota. Le
père Anselme. - Chevillard indique les croix d'argent. (DAGUIN, op.
cit.)
En 1666, intervient la transaction conclue entre Louis de La Rivière, évêque de Langres, pair de France, ministre d'État, commandeur des Ordres du Roi, Grand-Aumônier de la Reine, demeurant à Paris, en son hôtel de la place Royale, d'une part et Mre Maupeou, chevalier, seigneur de Monceau, conseiller du Roy en ses conseils et président ès enquêtes du Parlement de Paris, aux termes de laquelle, pour prévenir et terminer toute contestation, ce dernier cède au seigneur de Sennemont tout et tel droit de haute, moyenne et basse justice qui pouvait lui appartenir sur le château de Sennemont, vulgairement dit Petit-Bout, et reçoit de lui en contre-échange toute la haute, moyenne et basse justice faisant partie de celle d'Évry, appartenant audit seigneur évêque et duc de Langres, dans l'étendue du château de Monceau, sa ferme, ses cours, jardins, parcs et autres lieux. Archives départementales de Seine-et-Oise, cote G 248 (Liasse) - 8 pièces, papier.
Il teste le 24 septembre 1654, le 15 janvier 1655,
léguant au roi son buffet de vermeil doré et au duc d'Orléans sa maison
de Petit-Bourg (Insinuations du
Châtelet, Archives nationales, cote Y 217, f° 474), et le 22 mai 1669.
Par une de ses dispositions de dernière volonté, qui ne se trouve pas
dans son testament de 1655, Louis Barbier de La Rivière aurait donné 30
pistoles (cent dix écus) à l'auteur de son épitaphe d'honneur. Si tel
est le cas, ce ne fut pas une bonne idée. Il en eut trois fort
satiriques, dont celle-ci :
| Ci-gît un très grand personnage, Qui fut d'un illustre lignage, Qui posséda mille vertus, Qui ne trompa jamais, et qui fut toujours sage ; Je n'en dirai pas davantage, C'est trop mentir pour cent écus. |
Il s'inscrit comme l'un des principaux bienfaiteurs
du séminaire de Langres en léguant à cet établissement, par son
testament de 1669, la somme de 12.000 livres. Ce testament,
témoignage vivant de la piété et de la religion d'un prélat que
l'histoire ne nous représente pas comme exemplaire en toute chose,
contient des legs pour la somme de 663.150 livres non compris le
mobilier ni les biens patrimoniaux de cet évêque. Or, sur cette somme,
énorme pour le temps, il légua plus de 400.000 livres tant pour les
pauvres que pour les autres bonnes œuvres, dont 30.000 au diocèse de
Langres et 100 écus seulement pour son épitaphe. Ce dernier legs, un peu
mesquin, fut gagné par un de ses diocésains, le poète Lamonnoye, de
Dijon, qui lui composa la fameuse épitaphe, plus spirituelle que
charitable et plus mordante que sincère et véridique (Abbé Roussel, Le diocèse de Langres, T.4).
DAGUIN, op. cit., indique que le testament de Louis
Barbier se trouve aux Archives de la Haute-Marne, sous la cote G 24,
Évêché et Chapitre de Langres.
Peu de temps avant son décès, il se rend à Rome et en revient avec la promesse du cardinalat auquel il aspirait.
Il meurt à Paris, le 30 janvier 1670, à l'âge de 77 ans, dans son hôtel de la place Royale.
Ce fut par son seul mérite, d'autres disent par ses
intrigues, que Louis Barbier de La Rivière s'éleva aux premières charges
de l'État.
Pierre Barbier de La Rivière, son frère et héritier par bénéfice d'inventaire entrera en procès contre Guillaume de Beauvais.
Il est inhumé dans l'église Saint-Paul (ou aux Minimes de la place Royale, selon les auteurs), malgré son vœu d'une sépulture chez les Chartreux, auxquels il léguait 10.000 francs, ces derniers refusent son argent et son corps. Cf. Lettre (L. 977) de Guy Patin à André Falconet, 13 & 14 mars 1670.
L'Inventaire après décès de ses biens du 27 mars 1670 se trouve aux Archives nationales, minutier central, cote CV 825.
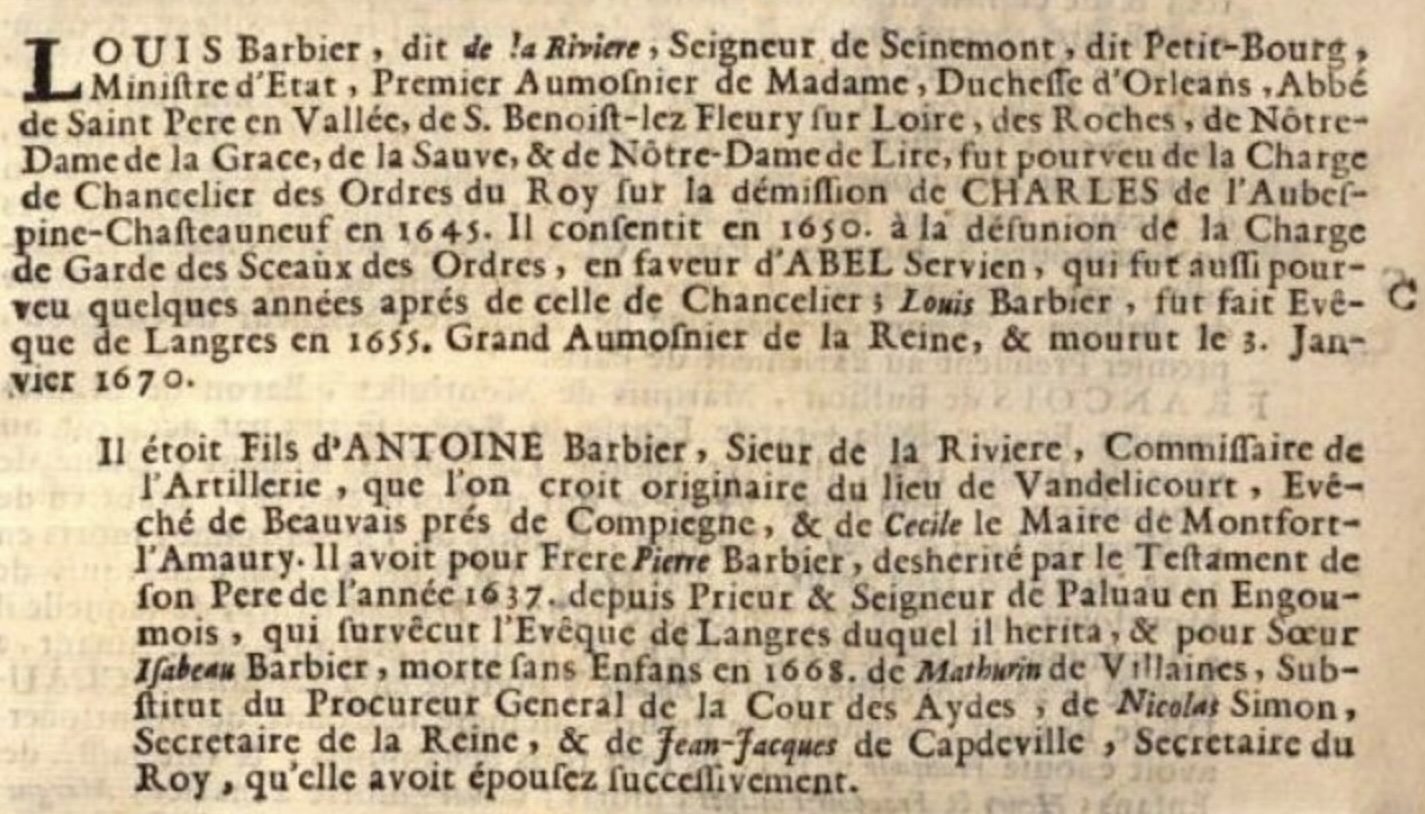
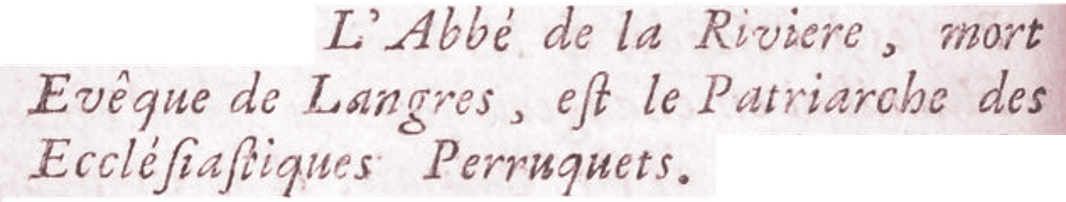 Les perruques très-communes aujourd'hui en France & dans les pays circonvoisins. Toute la Gaule était autrefois chevelue. Au commencement de la monarchie française, & longtemps depuis, il n'y avait que les rois de France qui eussent droit de chevelure, c'est-à-dire de porter cheveux longs. Ils ont joui de ce droit jusqu'au milieu du XIIe siècle. Depuis, & ils ont porté les cheveux courts, & point de perruques. Exemple mémorable de François Ier. Louis XIII reprit les cheveux longs. C'est sous son règne que les perruques d'hommes ont commencé en France. Les Courtisans, les rousseaux & teigneux en ont pris les premiers. Elles se sont multipliées depuis 1659. Les ecclésiastiques n'en ont porté que depuis 1660. Les abbés à la mode ont commencé à en porter, & ils ont été suivis par beaucoup d'autres ecclésiastiques de tous les Ordres. L'Abbé de la Rivière, mort évêque de Langres, est le Patriarche des ecclésiastiques perruquets. L'usage des perruques a toujours passé pour infâme dans l'Église, selon M. du Saussay, évêque de Toul. Il faut pourtant avouer que jamais les perruques d'hommes n'ont été plus commune qu'elles le sont à cette heure. (...) Les abbés, ou soi-disant tels, les abbés de Cour, les abbés damerets, les abbés à la mode, & c'est tout dire, cassèrent la glace le premiers pour les perruques, & ils ne firent pas grand scrupule d'en porter, voyant que les gens du monde avec lesquels ils ont tant d'autres rapport, n'en faisaient pas. Leurs perruques furent courtes & petites d'abord, & ces sortes de perruques s’appelèrent, comme elles s'appellent encore aujourd'hui, des perruques d'abbé ; et le premier qui en porta fut l'Abbé de la Rivière, qui est mort évêque de Langres, & que l'on peut par conséquent appeler avec justice, le Patriarche des ecclésiastiques perruquets. (THIERS, Histoire des perruques, 1690, p. 23-32.) |
Bibliographie :
Lettres de l'abbé Louis de la Rivière, depuis évêque de Langres, écrites depuis 1635 jusqu'en 1646. Manuscrit.
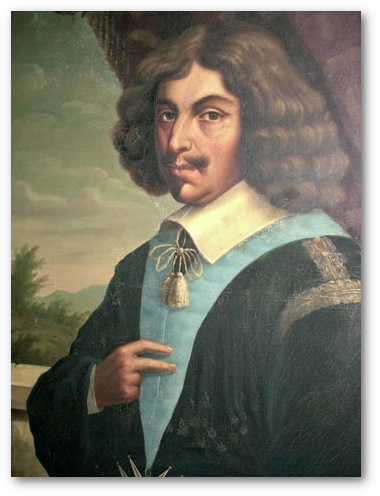
Sources :
Volumes consacrés à l'histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, Bibliothèque
nationale de France, département des manuscrits, cote Clairambault
1235, CXXV, années 1641-1654, 123 feuillets. Cote de substitution MF
11423, matrice R 135454.
Testaments du 18 janvier 1655 et 22 mai 1665, les deux in fol. de 4 pages (s.l.n.d.), Bibliothèque nationale, fol 4 n 27 37404 & 37 403 (DE L'HORME, Notes généalogiques).
La conférence du cardinal Mazarin avec le Gazetier, mazarinade, Bruxelles, 7 mai 1649, in 4°, 38 p.
TALLEMANT des RÉAUX (Gédéon.), Historiettes. Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIe siècle, tome I, Paris, 1657, MONMERQUÉ (Louis-Jean-Nicolas) & alii, Paris, 1834, p. 387.
THIERS (Jean-Baptiste, curé de Champrond), Histoire
des perruques, où l'on fait voir leur origine, leur usage, leur forme,
l'abus & l'irrégularité de celles des ecclésiastiques, Paris, 1690, Avignon 1777.
GUIBOURG (dit le père Anselme de Sainte-Marie, Pierre, de) & CAILLE (Honoré, du Fourny), Histoire
généalogique et chronologique de la Maison royale de France, des Grands
officiers de la Couronne et de la Maison du Roy, Tome second,
Catalogue des chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, Officiers de
l'Ordre du Saint-Esprit, Chanceliers et Garde des sceaux, Commandeurs
des Ordres du Roy, VIII C., Paris, 1712, p. 1758.
PEIGNOT (Étienne-Gabriel), La vie et les ouvrages de Bernard de La Monnoye, Mémoires de l'Académie des sciences et Belles Lettres de Dijon, Dijon, 1832, in-8°.
FISQUET (Honoré, de), La France pontificale, Gallia Christiana,
histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de
tous les diocèses de France, depuis l'établissement du Christianisme
jusqu'à nos jours, Paris, 1864, p. 340.
DAGUIN (Arthur), Les évêques de Langres. Étude
épigraphique, sigillographique et héraldique, Mémoires de la Société
historique et archéologique de Langres, Tome III, Langres, Paris, 1877.
ROUSSEL (Charles-François, abbé), Le diocèse de Langres, histoire et statistique,
tome IV, Librairie de Jules Sallet, éditeur, Langres, 1879, quatrième
partie, chapitre 1er - Séminaires diocésains. - Le Grand Séminaire de
Langres, p. 6.
MERLET, Bibliothèque chartraine, Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, volume 19, 1883, p. 19 à 21.
CORDA (A.), Catalogue des factums et autres documents judiciaires antérieurs à 1790, tome premier, Bibliothèque nationale, département des imprimés, Paris, 1890, Factum pour Mre Pierre Barbier de La Rivière (...) héritier par bénéfice d'inventaire de défunt Mre Louis Barbier de La Rivière (...) évêque (...) de Langres (...) contre Me Guillaume de Beauvais (...) et Mre Du Monstier, S. l. n. d., in-f° (f° Fm 821 et Thoisy, 239, f° 567). Réponse (f° Fm 822).
COÜARD (Émile), Inventaire sommaire des Archives départementales de Seine-et-Oise antérieures à 1790, Série G, articles 1-1167, 1895.
L'HORME (Édouard-Étienne-Arthur, baron de), Notes généalogiques, volume 1, familles d'Abemont à Berbis, Barbier de la Rivière, manuscrit. Don de sa fille, Mme la Comtesse Germaine Le Tourneur d'Ison, en 1973, Archives départementales de la Haute-Marne, cote 22 J 1.
DETHAN (Georges), La vie de Gaston d'Orléans, ed. de Fallois, Paris, 1992, p. 128-130.
BERGIN (Joseph), The Making of The French Episcopate (1589-1661), Yale University Press, New-Haven & London, 1996, p. 568-569.
SCOTT (Paul), Masculinité et mode au XVIIe siècle : L'Histoire des perruques de l'abbé J.-B. Thiers, in L'homme en tous genre. Masculinité, textes et contextes,
Revue Itinéraires, Littérature, textes, cultures, sous la direction de
Gary Ferguson, numéro inaugural, 2008, pp. 77-89 ; en ligne depuis le
1er décembre 2008, openedition.org/itineraires/2209 ; Éditions
L'Harmattan, 2009.
Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits,
édités par Loïc Capron, Bibliothèque
interuniversitaire de santé, Paris, 2018. Publication sur l'internet
réalisée par la direction des bibliothèques et musées de l'Université
Paris-Cité.
Archives départementales de la Seine-et-Oise, cote E 6899.